Propos recueillis par Véronique Patte

Nous pourrions peut-être commencer notre entretien par des questions sur votre travail de traductrice, puis aborder des aspects plus généraux de l’activité de traduction aujourd’hui en Russie. Je sais que vous avez traduit plus d’une soixantaine de romans, du français en russe (Queneau, Sagan, Modiano, Tournier, Echenoz, pour n’en citer que quelques-uns). Comment êtes-vous venue à la traduction vers le français ?
J’ai appris le français à l’école, puis, à l’Institut des langues étrangères Maurice Thorez, et j’ai toujours rêvé de devenir traductrice, parallèlement à mon travail de professeur de français. Un jour, je suis tombée sur le roman d’Agrippa d’Aubigné Les aventures du baron de Faeneste, et j’ai décidé, coûte que coûte, de le traduire en russe, sans le moindre contrat avec quelque maison d’édition que ce soit, sans rien – tout simplement, parce que je suis tombée amoureuse de son auteur dont j’avais déjà lu Sa vie à ses enfants en version russe.
Un coup de foudre en quelque sorte, pour la langue française, pour un auteur français, pour un roman. Êtes-vous tombée amoureuse d’autres langues étrangères, traduisez-vous d’autres langues que le français ?
Non, bien que ma seconde langue étrangère soit l’espagnol. La littérature française me suffit largement.
Vous êtes donc spécialisée dans le français. Vous cantonnez-vous dans le genre du roman ?
Pas spécialement. Les aventures du baron de Faeneste sont pendant longtemps restées mon violon d’Ingres : ce travail me prenait beaucoup de temps et d’efforts, car il exigeait des connaissances approfondies sur les XVIe et XVIIe siècles. Et comme je n’avais pas encore de contrat, que je travaillais pour ainsi dire « pour moi-même », je traduisais parallèlement d’autres textes : nouvelles, récits, poèmes, pièces que me proposaient différentes maisons d’édition.
Donc d’un côté, une histoire d’amour, de l’autre des textes commandés par des éditeurs. Quelle est la traduction du français qui vous a le plus marquée ?
Outre Agrippa d’Aubigné (sur lequel j’ai travaillé plus de 30 ans et qui a paru seulement en 2002), je citerai Les fleurs bleues de Raymond Queneau, les romans de Pascal Quignard (j’en ai traduit douze, j’adore cet auteur, c’est « l’homme de ma vie » numéro 2, après Agrippa), trois romans de Jean Giraudoux, Églantine, La Menteuse, Bella.
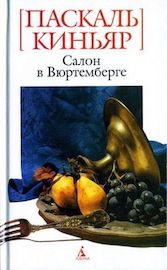

Vous avez étudié et traduit pendant la période soviétique. Quels ont été les effets de la fin de l’URSS sur le travail du traducteur en Russie ? Le volume des traductions a-t-il augmenté ?
Après la fin de l’URSS, pendant la perestroïka, l’édition a longtemps cherché sa place dans l’économie (on l’a appelée la période du capitalisme sauvage pendant laquelle chaque éditeur faisait ce qu’il voulait). Puis, peu à peu, la situation s’est stabilisée. Le volume des traductions aussi. Mais, bien sûr, sans les subventions d’État, les tirages ont beaucoup diminué (aujourd’hui le tirage moyen d’un roman est de 3 000 exemplaires, contrairement à la période communiste où les livres [des auteurs communistes] étaient tirés à des milliers d’exemplaires). En revanche, les éditeurs d’aujourd’hui ne sortent que des livres susceptibles d’intéresser le public. La qualité de l’édition s’est améliorée (concurrence oblige !), et aujourd’hui, sur le marché du livre, nous avons l’embarras de choix.
Quelle est la place de la littérature française dans l’édition aujourd’hui en Russie ?
Elle est assez importante vu que les liens culturels de nos deux pays ont toujours été solides, historiquement, surtout à partir du XVIIIe siècle : non-fiction (romans, nouvelles, récits, poésie), littérature dite documentaire (mémoires, essais, ouvrages scientifiques et para-sientifiques etc.).
Quelles sont les langues les plus traduites ? Je suppose que, comme en France, l’anglais domine (70% des livres traduits en France le sont de l’anglais ou de l’américain) ?
Vous avez raison, c’est bien cela, mais, à mon avis, la littérature anglaise perd peu à peu sa place dominante sur le marché russe des livres. Je peux toutefois me tromper.
Quel est le genre littéraire le plus traduit ?
Les romans tout court, les romans historiques, les mémoires, devenues du jour au lendemain très populaires, les romans policiers (souvent mauvais hélas !).
Pouvez-vous nous parler du statut social du traducteur dans votre pays ?
Le système d’assurance en Russie prévoit une « assurance-maladie » qui permet de se faire soigner dans les dispensaires et les hôpitaux de son quartier (gratuitement, mais la qualité des traitements laisse souvent à désirer). Sinon on peut s’adresser à des cliniques privées (aujourd’hui, elles sont innombrables) en payant … les yeux de la tête! Comme la traduction est une profession « libérale », le chômage pour nous, c’est l’absence de traductions ; il faut donc se débrouiller pour avoir des commandes, c’est à dire défendre sa réputation, accepter tous les livres qu’on vous propose et faire son travail vite et bien. Il n’existe pas de retraite spéciale pour les traducteurs, de même qu’il n’existe pas d’assurance-maladie spéciale. On touche une retraite « comme tout le monde », à partir de 55 ans pour les femmes et de 60 ans pour les hommes. Plus les honoraires pour les traductions (en payant des impôts, bien sûr!). Pour l’aide sociale, c’est la même chose, c’est à dire, comme pour tout le monde. En fait, la situation du traducteur en Russie se détériore, comme dans presque tous les autres domaines, à cause de la crise économique. Mais la qualité des traductions reste à un très haut niveau, comme elle l’a toujours été, depuis le début du XXe siècle (la fameuse école russe de traduction !).
Justement, pourriez-vous nous dire quelques mots sur cette « fameuse école », citer quelques noms ?
C’est grâce à une pléiade de traducteurs des littératures française, espagnole, anglaise, italienne, allemande, que les lecteurs russes ont connu toute la littérature classique de ces pays, tels que Nicolai Lioubimov (Proust, Maupassant, Flaubert), Maria Laurier (Galsworthy, The Forsyte Saga – traduction absolument géniale !), Gorkina, Nemtchinova et Jarkova (Lion Feuchtwanger), Solomon Apt (Thomas Mann, Joseph und seine Bruder) et beaucoup d’autres qui ont travaillé dans les années 1930-1970 et dont les traductions sont devenues, comme on dit chez nous, « le fait de la littérature russe ». Nous autres, les “jeunes”, avons appris l’art de la traduction grâce à ces maîtres, à leurs travaux et à leurs conseils. Personnellement, j’ai pris part au séminaire de la traductrice Lilianna Lounguina où nous avons traduit des récits de Boris Vian sous sa direction, et ses conseils nous ont aidés à comprendre les principes et les règles d’une vraie traduction. On se réunissait chez elle, dans sa maison, on analysait le texte de chacun de nous et le souvenir de ces réunions m’est précieux aujourd’hui encore.
Peut-on vivre de la traduction en Russie ?
Pratiquement pas, vu que ce n’est pas un travail assuré, régulier. C’est tantôt deux livres à traduire à la fois, tantôt aucune traduction pendant quelques mois. Il y a très peu de traducteurs ou de traductrices qui peuvent vivre de leurs traductions, à part ceux qui traduisent des romans policiers à grands tirages. Les éditeurs, qui ont l’embarras du choix parmi les traducteurs, en profitent pour payer leur travail de plus en plus mal.
À propos, pourriez-vous nous dire quelques mots sur le contrat de traduction ?
Le contrat de traduction fixe le montant des honoraires. Le calibrage en Russie est le suivant : on n’est pas payé au feuillet, mais à la « liste » qui compte 40 000 signes ou 22 pages de 1 800 signes espaces et blancs compris. Aujourd’hui, une « liste » est rémunérée de 3 500 à 6 000 roubles. Moi, pour la traduction du premier volume du roman de C. Dabos, j’ai touché 4 500 roubles par liste, mais le contrat pour le second volume m’a proposé 6 900 roubles (!), ce qui veut dire que l’éditeur tient à me garder, étant donné que je traduis assez vite et sans fautes. On est donc payé au forfait. Pas de pourcentage sur les ventes, faute d’information sur le nombre des livres vendus (l’éditeur pouvant toujours dire que le livre ne se vend pas!). Le traducteur peut proposer sa traduction à un autre éditeur après 5, 7 ou 10 ans pendant lesquels les droits appartiennent au premier éditeur. Les honoraires sont d’habitude virés soit sur la carte de crédit soit sur le compte bancaire du traducteur. Heureusement, comme je touche une retraite correcte (un bon mot : une retraitée demande à son amie: “Tu touches une bonne retraite?” “Oh, oui, très bonne mais… petite”), je peux me permettre de choisir les livres que je traduis et les éditeurs avec lesquels je préfère avoir affaire. Pour vous donner une idée plus précise, 4 500 roubles, cela équivaut à 75 euros par « liste » (22 pages,1 800 signes), ce qui fait 204,50 roubles (3 euros 40 centimes) par feuillet (1 euro = 60 roubles). Une belle philanthropie, n’est-ce pas? Pour votre information : avec 204,50 roubles on peut acheter aujourd’hui 1 kilo de viande ou de poisson (pas chers) ou une livre de fromage, ou 300 grammes de saucisson, un point c’est tout. Mais je ne me plains pas, avec cela, plus ma retraite, plus, parfois, des subventions françaises et suisses pour mes traductions, je réussis non seulement à vivre correctement, mais aussi à voyager un peu : ainsi, l’année dernière, j’ai visité Venise où j’ai passé sept jours passionnants à parcourir la ville, les musées et les églises ! Et l’été dernier, j’ai passé 15 jours à la mer, en Bulgarie.
Les traducteurs ont-ils des associations pour les représenter, défendre leurs droits ?
Il existe l’Union des traducteurs de Russie (Союз переводчиков России – СПР), dont je suis membre et la Guilde des traducteurs de Moscou (Гильдия переводчиков Москвы) dont je suis membre également. Mais ce sont des institutions plutôt culturelles : on se réunit assez régulièrement à l’occasion de rencontres avec des auteurs, de présentations, de débats, etc. Quant à la défense des droits, hélas, on doit se débrouiller comme on peut, c’est-à-dire discuter le prix de la traduction en tête à tête avec l’éditeur. C’est le marché « libre » – à prendre ou à refuser. Si, il y a bien une Agence des droits des écrivains et des traducteurs (FTM), mais elle est si peu efficace que presque personne ne s’adresse à elle.
Existe-t-il en Russie des formations universitaires, post-universitaires, une formation continue dans le domaine de la traduction ?
En Russie, il y a des formations universitaires et post-universitaires, par exemple, une de mes amies, Natalia Mavlevitch, organise des séminaires pour les jeunes traducteurs, étudiants, des concours de traduction etc. C’est utile et intéressant : comme je l’ai déjà dit, j’ai moi-même dans ma jeunesse fréquenté le séminaire de la fameuse traductrice Lilianna Loungina et cela a été pour nous tous, ses élèves, une formidable leçon de maîtrise de la traduction.
Notre association, l’ATLF, se bat pour que le nom du traducteur soit mentionné sur la première de couverture, dans la presse, à l’occasion des prix littéraires etc… J’ai remarqué qu’en Russie le nom des rédacteurs et des correcteurs était cité, est-ce obligatoire et à quelle page ?
Oui, c’est obligatoire. Ainsi que le nom de la Fondation qui a subventionné la publication (si c’est le cas). Les noms des rédacteurs et correcteurs sont toujours cités, c’est obligatoire, à la fin du livre, avec ceux qui composent le texte et qui l’illustrent, le nom de l’imprimerie, bref, tous ceux qui ont travaillé sur le livre.
Existe-t-il un ou des prix de traduction ?
Il y en a plusieurs : le Prix de l’ambassade de France Maurice Waxmaher (c’est le fameux traducteur russe) – pour la traduction d’un roman. J’ai personnellement reçu ce prix deux fois : en 1997, pour la traduction du roman d’un jeune auteur, Yann Moix, Les jubilations vers le ciel et, en 2008, pour la traduction des romans Le salon du Wurtemberg de Pascal Quignard et Cherokee de Jean Echenoz. Il existe aussi le Prix de l’ambassade de France Leroy-Beaulieu pour une œuvre (traduite ou écrite) sur la culture française. Il y a aussi le prix du « Meilleur Livre de l’année » que j’ai obtenu en 2005 pour la traduction du recueil de cinq œuvres de Pascal Quignard. Nous avons aussi le Prix de la revue littéraire « Inostrannaïa literatoura» (Littérature étrangère), notre meilleure revue qui publie des traductions de toutes les langues. Nous avons aussi les « diplômes » de la Guilde des traducteurs qui sont attribués, une fois par an, aux meilleures traductions de la littérature pour adultes, pour enfants, etc. dans le domaine de la prose comme dans celui de la poésie. J’ai été « diplômée » trois fois: pour la traduction du roman d’André Maurois La terre promise ainsi que pour la traduction du roman pour enfants de Timothée de Fombelle Vango et enfin pour la traduction du roman-poème de David Foenkinos Charlotte.
Merci, Irina, pour ce petit tour d’horizon !
