La joute de traduction entre Mireille Vignol et Catherine Richard a donné lieu à un extraordinaire dialogue des traductrices avec l’auteur du poème, Robert Robbins.
Le 17 mars 2021, dans le cadre de la Semaine de la poésie, Catherine Richard et Mireille Vignol faisaient assaut de traduction sur un texte du poète américain Robert Robbins : « Counting Cats in Zanzibar ».
La vidéo de cette joute est accessible sur notre site YouTube, et son compte rendu ainsi que les premières traductions de Catherine Richard et Mireille Vignol sur notre blog.
Mais l’histoire ne s’arrête pas là….
« À l’issue de la joute, les questions que nous nous posions étaient encore plus foisonnantes. Mais cette fois, à notre grande satisfaction, il devenait possible de joindre Robert Robbins, notre auteur on ne peut plus vivant !
De son côté, Robert Robbins a suivi la joute et, en fin francophone qu’il est, nous a fait l’excellente surprise de nous adresser un mot en français :
Robert Robbins : Il faut vous dire comment je suis content d’y participer à distance comme auteur mystérieux. J’étais vraiment touché par le travail de ces deux traductrices exceptionnelles et par leur traitement de ce texte qui leur est tombé du ciel. Comme Mireille a dit, « si l’auteur était mort, c’est un autre problème. » C’est le rêve de tout poète d’avoir des lectrices tellement attentives à la musique et au sens de ses vers, et j’ai beaucoup appris moi-même en écoutant leur interprétation, nécessaire à toute traduction, mais surtout aux traductions poétiques. J’étais parfois amusé par leurs spéculations mais je trouve qu’elles ont toutes les deux saisi les éléments les plus importants et émotifs et intellectuels derrière ces vers et j’hésite à donner le palmarès en reconnaissance des choix heureux de ces deux traductrices.
Je leur remercie à distance et je suis honoré de cette lecture engagée.
Les échanges ont aussitôt commencé…
… par nos excuses les plus contrites, pour être l’une et l’autre passées à côté de la référence à Henry David Thoreau… »
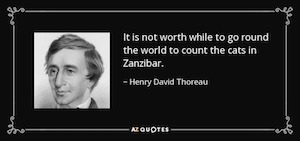
Robert Robbins : En ce qui concerne Henry David, l’épisode a eu le mérite de procurer une ouverture comique à votre lecture très intelligente, mais la référence à cet auteur, tout instructive qu’elle soit, est à peine nécessaire. À vrai dire, je cherchais à me moquer gentiment de ce pauvre Henri David Thoreau qui n’est jamais allé plus loin que le bois derrière la maison de ses parents. C’est l’un des poèmes d’un ensemble de cinq de forme et de ton très différents, que j’ai écrits après avoir relu Walden l’an dernier. (Traduction M. V.)
Counting Cats in Zanzibar
Robert Robbins
To Henry David Thoreau
 In the rocking before sleep, my bones would buzz with the sea’s sibilant whisper and the scuffle of palms along the bay above a pier where the reek of fish seeks out the salt. It is all written on the last leaf of a book that brings walrus and yak together, back to back, before the island appears. Moored on a bed of bundled blankets, bored with breathing dry dust all day long, I inhale the nutmeg and vanilla of the harvest tumbled into baskets and watch black faces enveloped in white robes processing through the streets. A weaving of cinnamon and slaves, cinnabar and sorrow.
In the rocking before sleep, my bones would buzz with the sea’s sibilant whisper and the scuffle of palms along the bay above a pier where the reek of fish seeks out the salt. It is all written on the last leaf of a book that brings walrus and yak together, back to back, before the island appears. Moored on a bed of bundled blankets, bored with breathing dry dust all day long, I inhale the nutmeg and vanilla of the harvest tumbled into baskets and watch black faces enveloped in white robes processing through the streets. A weaving of cinnamon and slaves, cinnabar and sorrow.
Yet, I am too young still to smell the sweat of twisted limbs or taste the tang of any but my own tears. A harsh word weighs heavier than chains around my neck’s twig, and a spark of dragonfly against the pines is as soothing as a balm of benzoin and camphor when the panic mounts. I smell the gutted fish waiting for the pan. I feel the slick the swirl of intestines and the button heart in my hand.
And where there are fish scales and entrails glittering on the wet wood, there are cats, innumerable and luminous in the perfumed glow of evening star and fitful flames, who come to claim what’s owed them from the catch. I am impatient with what comes first, with the flinging of the nets and the haul of muscled fisherman, indifferent to this great harvest, even, but long for what comes after, what comes last, like these cats.
More attentive to the echo than the call, to the faraway reverberation of a plea outside a roadside shack, the stamp of sandals in the trodden sand, the gasping groan of flesh and fearful worryings, the high holy summons of the black birds circling. I listen for the ones who follow, then abandon, the bloody traces of quick uncaring men who dominate and in dominion dwell like gods deserted by their creation.
I listen for the catspaw but it makes no noise. Watch the whiskers twitch with hunger, smell the clover in their clotted fur. Taste the oily salt of sardines. Wince at the pinprick of claws closing that with a sigh retract. I forget to eat but wait and watch. I should not count them but I do, the cats in Zanzibar.
N.B. : sauf indication contraire, tous les contenus présents sur le site de l’ATLF sont couverts par le droit d’auteur (voir les mentions légales).
Questions de Catherine Richard et Mireille Vignol
Réponses de Robert Robbins
(traduites par Mireille Vignol)
Catherine & Mireille : En anglais, rien n’indique si la narration est au féminin ou au masculin. En français, nous devons choisir. Dans votre esprit, s’agit-il d’un narrateur ou d’une narratrice ?
Robert Robbins : Le choix d’une narratrice me paraît bon. Comme vous l’avez observé pendant la joute, il n’y a aucune raison d’opter pour l’un ou l’autre si ce n’est en se basant sur le nom de l’auteur. C’est pourquoi le choix d’une narratrice peut susciter une lecture plus intéressante.
J’ai beaucoup aimé la manière dont vous vous êtes emparées d’éléments du poème pour créer ensemble une version formidable. Il s’agit à la fois d’une voix d’enfant et d’adulte, en surimpression, des rêveries pensives d’une narratrice alitée et d’une rêveuse sur un bateau arrivant à Zanzibar. Il ne me reste plus qu’à m’excuser de vous avoir tant angoissées en utilisant la même surimpression du présent et du passé.
J’ai aussi trouvé drôle de débattre du choix entre « à Zanzibar » et « de Zanzibar » : les chats sont-ils zanzibariens ou des chats du Vermont qui se retrouvent soudain à Zanzibar après des mois à attraper des souris pendant le voyage ? Je vois là le sujet d’un nouveau poème.
Catherine & Mireille : Dans la phrase « I smell the clover in their clotted fur » [Je sens le trèfle dans leur fourrure crottée], s’agit-il d’une coquille? Devrait-on lire « cloves » (girofle, clous de girofle) à la place de « clover » (trèfle) ? Le trèfle ne semble pas sentir très fort.
RR : Vos doutes ne pouvaient pas mieux tomber. Ce n’était pas une erreur, mais vous m’avez convaincu que j’aurais bel et bien dû parler de girofle. Le trèfle des prés (ou trèfle violet) est la fleur envahissante la plus commune des prairies du Vermont où j’habite, c’est même la fleur de notre État, et les chats qui en mangent trop ont tendance à tomber malades. Mais les clous de girofle sont beaucoup plus efficaces pour transporter les lecteurs dans un espace imaginaire et, comme seuls les habitants du Vermont seraient en mesure de faire le lien avec le trèfle, je l’ai changé dans mon poème.
Catherine & Mireille : Peut-on remplacer le mot « Walrus » [morse en français] par un animal au nom en W pour garder la progression des lettres de l’album (Walrus, Yak, Zanzibar) ?
Robert Robbins : Oui, c’est bien un abécédaire et que ce soit wapiti ou wallaby, le W est essentiel.
Catherine & Mireille : L’une de nous a traduit « catspaw » en risée [brise marine + dupe], l’autre en pattes de chats. Parlez-nous de vos « catspaw » !
Robert Robbins : Cat’s paw ou catspaw est bien sûr la patte du chat, mais par une heureuse coïncidence, ces lettres décrivent également quelque chose de plus complexe. C’est la brise qu’on peut sentir sur la jetée, mais aussi une expression idiomatique pour parler de quelqu’un qui se fait duper, un pigeon. Vous m’accorderez que c’est une réflexion plutôt adulte et au mieux une forme de digression, mais figurez-vous qu’elle trouve ses origines chez La Fontaine, me semble-t-il, et qu’elle était le titre d’un épisode de Star Trek ! [Catspaw ou en version française : Dans les griffes du chat]. Il serait impossible de ressentir tout cela en une même lecture sans risquer d’avoir le souffle coupé ou de tomber dans les pommes, je ne peux donc guère le recommander.
Catherine & Mireille : « When the panic mounts » [quand monte la panique] : qu’est-ce qui déclenche la panique de la narratrice ? Et peu après : « the slick the swirl ». Aurait-on dû garder ce double « the » avec quelque chose comme « sous mes doigts l’amas le glissement des intestins » ? Seriez-vous d’accord ?
Robert Robbins : Votre question sur la panique, sur la peur irrationnelle de l’enfant qui maîtrise très peu le monde dans lequel il ou elle vit, est très subtile car elle survient juste avant « the swirl the slick ». Excusez-moi encore de vous avoir fait douter de mes connaissances grammaticales. Votre sollicitude était émouvante et drôle, comme l’était votre désir de m’accorder le bénéfice du doute. Il s’agit en fait d’une sorte de bégaiement des mots. En anglais parlé, « slick » peut être un verbe ou un nom, comme « swirl », mais la répétition de l’article sans ponctuation vise à capturer la panique des émotions, la perte de contrôle de l’enfant, en même temps que la sensation d’arracher les entrailles du poisson et de les jeter au chat avant que le poisson finisse dans la poêle pour le bénéfice de l’homme.
Une fois éclaircis ces points nébuleux, nous avons décidé de mettre au point une version aboutie du poème, à proposer à Robert Robbins dans un premier temps, puis à nos collègues traducteurs.
Prétexte idéal pour nous réunir au jardin et passer un bel après-midi de soleil à retravailler les détails en mangeant une brioche. Aux dernières miettes, nous en étions à remettre les virgules que nous avions supprimées et le poème avait pris la forme que voici :
Compter les chats de Zanzibar
Traduction de Catherine Richard et Mireille Vignol
À Henry David Thoreau
Dans le bercement de la somnolence, mes os résonnent du chuchotis chuintant de l’océan et des frictions des palmiers le long de la baie au-dessus d’un quai où le relent de poisson traque le sel. Tout est écrit à la dernière page d’un album qui rapproche wallaby et yack, dos à dos, avant que l’île n’apparaisse. Amarrée à un capharnaüm de couvertures, lassée d’inhaler de la poussière à longueur de journée, je hume la muscade et la vanille de la récolte jetée en vrac dans des paniers et regarde la procession de visages noirs drapés de blanc dans les rues. Tresses de cannelle et d’esclaves, de cinabre et de tristesse.
Pourtant je suis trop jeune encore pour sentir la sueur de membres déformés ou goûter l’âcreté d’autres larmes que les miennes. Une réprimande pèse plus lourd que des chaînes autour de la brindille qu’est mon cou, et l’étincelle d’une libellule sur un pin est aussi apaisante qu’un baume de camphre et benjoin quand monte la panique. Je sens l’odeur du poisson vidé qui attend la poêle à frire. Et dans le creux de ma main l’amas visqueux les viscères le cœur pas plus gros qu’un pois. Et là où écailles et entrailles de poissons luisent sur le bois imbibé, il y a des chats, innombrables et lumineux dans la lueur parfumée de l’étoile du berger et des flammes affolées, qui viennent tous réclamer leur dû. Je n’éprouve guère de patience pour ce qui précède, les lancers et coups de filet d’un pêcheur musclé, et de l’indifférence, même, pour cette moisson, mais j’ai hâte de voir ce qui vient après, ce qui vient en dernier, comme ces chats.
Attentive à l’écho plus qu’à la clameur, à la réverbération d’une supplique devant une case en bord de route, au piétinement de sandales dans le sable, à la plainte pantelante de la chair et aux chagrins angoissés, à l’injonction suprême des oiseaux noirs tournoyant dans les cieux. Je tends l’oreille, guette ceux qui suivent puis abandonnent le sillage sanglant d’hommes bâclant la besogne qui dominent et règnent sur leurs dominions tels des dieux désertés par leur création.
Je guette les bruits de pas, mais les pattes de chat n’en font pas. Regarde les moustaches frémir de faim, sens le girofle dans les fourrures crottées. Goûte le sel huileux des sardines. Grimace aux piqûres de griffes qui se rétractent avec un soupir. J’oublie de manger, je fais le guet. Je ne devrais pas mais je les compte pourtant, les chats de Zanzibar.
N.B. : sauf indication contraire, tous les contenus présents sur le site de l’ATLF sont couverts par le droit d’auteur (voir les mentions légales).
En conclusion, l’amicale approbation en français du poète – une gratification rare !!
« Chères Mireille et Catherine,
Quel beau cadeau de printemps que je reprenne à la boîte virtuelle ce matin. Je ne change rien. Le poème s’incarne en français sans perdre les réverbérations de la musique de la version originale. Je vous remercie de ce travail, ce jeu, assidu et enthousiaste.
Je vous souhaite une issue heureuse de ce long cauchemar de pandémie et une saison florissante à venir. »














