[boxed_content type= »coloured » custom_bg_colour= »#F5ECCE » custom_text_colour= »#000000″ pb_margin_bottom= »no » width= »2/3″ el_position= »first last »]
Pour qui souhaiterait faire un petit voyage en Toscane, et plus précisément à Florence, on ne saurait trop recommander le premier volume des enquêtes du commissaire Bordelli, de Marco Vichi. Début des années 60, en plein été, une vieille dame très riche meurt d’une crise d’asthme. Mais les apparences sont trompeuses et Bordelli devine très vite que l’histoire est un peu plus compliquée. Aidé du jeune Piras, fils d’un ancien compagnon de guerre, il va tenter de démêler un écheveau de relations familiales qui pourrait bien être à l’origine du trépas de la dame.
 Le texte a beaucoup de charme, on y retrouve des ingrédients à l’efficacité éprouvée : des personnages truculents, l’amour de la vie et de la bonne chère, une intrigue tortueuse à souhait. Et aussi cette mélancolie propre aux romans policiers qui jouent la carte de l’humanité plutôt que celle de la violence exacerbée. Une mélancolie qui renvoie ici également à la guerre, dont on sent encore les traces dans les mémoires et les corps. Un grand nombre des personnages sont des vétérans, et leurs retrouvailles autour d’un bon dîner s’accompagnent presque inévitablement de récits des années de guerre, où l’on perçoit le désir têtu de retrouver l’individu sous l’uniforme.
Le texte a beaucoup de charme, on y retrouve des ingrédients à l’efficacité éprouvée : des personnages truculents, l’amour de la vie et de la bonne chère, une intrigue tortueuse à souhait. Et aussi cette mélancolie propre aux romans policiers qui jouent la carte de l’humanité plutôt que celle de la violence exacerbée. Une mélancolie qui renvoie ici également à la guerre, dont on sent encore les traces dans les mémoires et les corps. Un grand nombre des personnages sont des vétérans, et leurs retrouvailles autour d’un bon dîner s’accompagnent presque inévitablement de récits des années de guerre, où l’on perçoit le désir têtu de retrouver l’individu sous l’uniforme.
Bordelli est hanté par le dernier conflit mondial, et l’on devine que cette noirceur est peut-être ce qui le tient un peu en marge de la vie, de l’amour et d’une forme de vitalité qu’il admire chez autrui. Il y a dans ce roman un savant mélange de drôlerie et de nostalgie, de dureté et d’humanité, d’absurdité et de sens, qui crée une atmosphère très particulière. Le ton en est très bien rendu par la traduction, en sympathie avec le texte.
Marco Vichi
Le Commissaire Bordelli
Traduit de l’italien par Nathalie Bauer
Philippe Rey, 2015
[/boxed_content] [blank_spacer height= »30px » width= »2/3″ el_position= »first last »] [boxed_content type= »coloured » custom_bg_colour= »#EFF8FB » custom_text_colour= »#0B0B61″ pb_margin_bottom= »no » width= »2/3″ el_position= »first last »]
Une découverte, celle des poèmes de l’Américain Robinson Jeffers (1887-1962), dont les éditions Wildproject nous offrent « la première anthologie qui lui est consacrée en français ». Traducteur et éditeur ont fait le choix de privilégier les poèmes « courts », dans une présentation qui permet d’entendre au mieux la force de cette voix singulière.
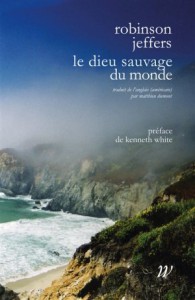 Ce qui frappe à la lecture de ces textes magnifiquement traduits, c’est l’intensité avec laquelle est rendu le chant de la nature – celle, notamment, de la côte californienne où le poète s’est installé. Nature immémoriale, qui perdure en dépit de tous les changements provoqués par l’homme et qui apparaît comme un étalon de mesure impitoyable face à la vanité des passions, de la violence et de l’arrogance. Nulle idéalisation, pourtant, car Jeffers est un observateur tout aussi attentif à la somptuosité de la nature et de ses hôtes qu’à la violence qui se déploie quand il faut survivre. La vie et la mort sont intimement et perpétuellement liées, à ceci près que la nature, par sa constance, échappe à l’irrationalité criminelle de l’homme.
Ce qui frappe à la lecture de ces textes magnifiquement traduits, c’est l’intensité avec laquelle est rendu le chant de la nature – celle, notamment, de la côte californienne où le poète s’est installé. Nature immémoriale, qui perdure en dépit de tous les changements provoqués par l’homme et qui apparaît comme un étalon de mesure impitoyable face à la vanité des passions, de la violence et de l’arrogance. Nulle idéalisation, pourtant, car Jeffers est un observateur tout aussi attentif à la somptuosité de la nature et de ses hôtes qu’à la violence qui se déploie quand il faut survivre. La vie et la mort sont intimement et perpétuellement liées, à ceci près que la nature, par sa constance, échappe à l’irrationalité criminelle de l’homme.
On est saisi par la force des images, par le rythme enfiévré de certains poèmes, par la mélodie rendue avec brio, par l’âpreté des descriptions qui allient avec un rare bonheur énergie et douceur.
C’est toute une réflexion sur l’homme et son devenir qui se joue dans ces textes parfois poignants, où l’on sent le désespoir de Jeffers, son désir forcené de faire entendre raison à ses contemporains, de se libérer du poids de l’histoire pour accéder, enfin, à une dimension «impersonnelle » où l’on puisse être en accord avec soi.
Robinson Jeffers
Le Dieu sauvage du monde
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Matthieu Dumont
Éditions Wildproject, 2015
[/boxed_content]
