Chronique de quelques détraquements…
D’Andrus Kivirähk, nous avions déjà signalé L’homme qui savait la langue des serpents (trad. Jean-Pierre Minaudier), aux éditions du Tripode. Voici à présent Les groseilles de novembre, considéré en Estonie comme son meilleur roman.
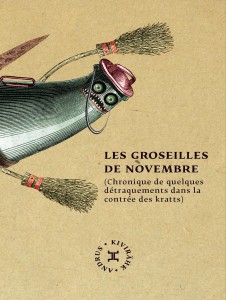 Chronique au jour le jour d’un petit village estonien, Les Groseilles nous plonge dans le quotidien farcesque et cruel d’une communauté d’hommes et de femmes qui essaient tant bien que mal de survivre dans un environnement hostile. Kivirähk dépeint un univers où les vivants et les morts communiquent, où le diable – le Vieux-Païen – est constamment à l’affût de nouvelles âmes, où les démons prospèrent et où les kratts, serviteurs créés de toutes pièces par les hommes, sont chargés de les approvisionner en vivres et en biens. La disparité sociale entre le manoir et les villageois crée des ressentiments durables et favorise tant les actes de vengeance que les aspirations vaines. Certains, pourtant, essaient de réguler les forces chaotiques qui se donnent libre cours – le « granger », la sorcière –, mais les victoires, pour satisfaisantes qu’elles soient, n’empêchent pas la tristesse, la solitude et l’incertitude.
Chronique au jour le jour d’un petit village estonien, Les Groseilles nous plonge dans le quotidien farcesque et cruel d’une communauté d’hommes et de femmes qui essaient tant bien que mal de survivre dans un environnement hostile. Kivirähk dépeint un univers où les vivants et les morts communiquent, où le diable – le Vieux-Païen – est constamment à l’affût de nouvelles âmes, où les démons prospèrent et où les kratts, serviteurs créés de toutes pièces par les hommes, sont chargés de les approvisionner en vivres et en biens. La disparité sociale entre le manoir et les villageois crée des ressentiments durables et favorise tant les actes de vengeance que les aspirations vaines. Certains, pourtant, essaient de réguler les forces chaotiques qui se donnent libre cours – le « granger », la sorcière –, mais les victoires, pour satisfaisantes qu’elles soient, n’empêchent pas la tristesse, la solitude et l’incertitude.
Cet univers fantasmagorique expose sous une forme condensée tout ce qui fait le quotidien de notre monde : cupidité, bêtise, cruauté, mais aussi rêve, poésie, désir de vivre et d’aimer. Expression d’appétits bornés, l’incroyable violence qui est à l’œuvre dans ce texte pourrait néanmoins passer aussi pour l’explosion d’une vitalité désordonnée. On sent de l’informulé, de l’énergie en gestation. La porosité des frontières entre les vivants et les morts, les hommes et les démons, produit des va-et-vient déstabilisants, sources de méfiance et de crainte. Est-on dans un univers « primitif », qui renverrait à une époque antérieure aux « lumières » ? Ou s’agit-il du reflet d’une réalité bien plus mouvante ? Le conte, ici, servirait-il de révélateur à la complexité de ce qui nous hante ?
D’une grande truculence, le texte est traduit avec beaucoup d’inventivité et un constant bonheur d’expression qui restitue au mieux la singularité de cet univers littéraire.
Andrus Kivirähk
Les groseilles de novembre
Traduit de l’estonien par Antoine Chalvin
Le Tripode, 2014
Parmi les ouvrages que les célébrations du centenaire de la Première Guerre mondiale nous ont permis de redécouvrir, il y a Schlump de Hans Herbert Grimm, publié en 1928. Le texte a connu un destin tourmenté : brûlé par les nazis en 1933 et redécouvert dans des circonstances dignes d’un roman, il vient tout juste d’être réédité en Allemagne, et traduit en français.
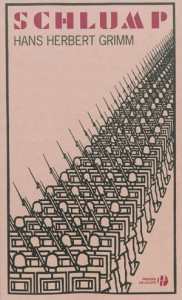 Récit « picaresque » des (més)aventures d’un jeune engagé volontaire, le texte frappe par la richesse de ses aperçus. À travers Schlump, le protagoniste de cette histoire, nous vivons à l’heure de quelques villages français administrés, de façon bienveillante, par l’occupant allemand ; nous pénétrons dans les arcanes de la vie des campagnes ; nous montons au front et découvrons l’enfer des tranchées ; nous fréquentons l’univers des blessés de guerre ; nous retournons à « l’arrière » ; nous faisons la connaissance de profiteurs et d’escrocs en tout genre ; et nous suivons les péripéties qui permettent à un jeune homme pacifique, amoureux de la vie et des femmes, de sortir à peu près indemne d’un conflit meurtrier.
Récit « picaresque » des (més)aventures d’un jeune engagé volontaire, le texte frappe par la richesse de ses aperçus. À travers Schlump, le protagoniste de cette histoire, nous vivons à l’heure de quelques villages français administrés, de façon bienveillante, par l’occupant allemand ; nous pénétrons dans les arcanes de la vie des campagnes ; nous montons au front et découvrons l’enfer des tranchées ; nous fréquentons l’univers des blessés de guerre ; nous retournons à « l’arrière » ; nous faisons la connaissance de profiteurs et d’escrocs en tout genre ; et nous suivons les péripéties qui permettent à un jeune homme pacifique, amoureux de la vie et des femmes, de sortir à peu près indemne d’un conflit meurtrier.
Un texte de plus sur la guerre ? Ce serait sous-estimer sa portée que de le ranger dans une catégorie trop bien circonscrite. Il s’agit certes d’un témoignage de première main, mais c’est aussi une œuvre littéraire qui, sans en avoir l’air, creuse au plus profond pour faire émerger la violence. La violence de la guerre, exposée au travers de pages d’une rare noirceur, mais aussi celle qui s’imprime dans l’âme de ses victimes. La description idyllique et malicieuse des villages français est bien là pour faire sentir la monstruosité de ce qui se joue dans l’affrontement des états majors. Il y a dans ce « roman » une douleur qui ne se dit pas, mais qui montre ce que l’homme est capable de faire à l’homme. De ce point de vue, la peinture très contrastée de cette « der des ders » ne fait que souligner l’insupportable contradiction qu’il y a à vouloir la vie tout en étant obligé de donner la mort.
Le texte réussit à conjuguer une grande diversité de registres, comique, poésie, violence, horreur, onirisme, avec une constante justesse de ton. Le style, extrêmement vivant et alerte, est particulièrement bien rendu par une traduction attentive au rythme, aux spécificités du lexique, aux changements de registre.
Hans Herbert Grimm
Schlump
Traduit de l’allemand par Leïla Pellissier
Presses de la Cité, 2014




