[fullwidth_text alt_background= »none » width= »1/3″ el_position= »first »]
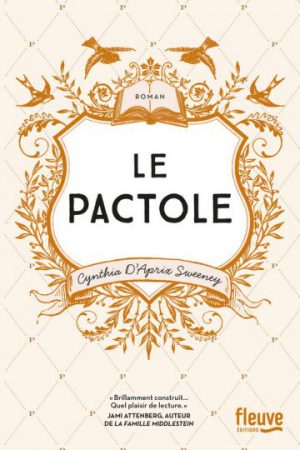
Dernière traduction parue : Le pactole, premier roman de Cynthia d’Aprix Sweeney (Fleuve). Ils sont quatre frères et sœurs, orphelins de père. Depuis toujours, on leur a promis que lorsque la benjamine fêterait ses 40 ans, ils toucheraient le pactole : un fonds de placement judicieusement géré qui a fait de nombreux petits. Mais lorsqu’un membre de la fratrie dérape, l’argent fond comme neige au soleil…
Un premier roman bien écrit, bien mené, dans le New York d’aujourd’hui.
[/fullwidth_text] [spb_text_block pb_margin_bottom= »no » pb_border_bottom= »no » width= »2/3″ el_position= »last »]
Elle a la voix douce, le rire au bord des lèvres, et l’amour du métier. Elle a traduit Mary Higgins Clark, Michael Cunningham, Jane Smiley et bien d’autres.
Rencontre avec une passeuse de mots talentueuse.
Pourquoi traduis-tu ?
J’ai fait des études de lettres et travaillé dans l’édition, la télévision, la communication. J’aimais lire. J’ai eu la chance de rencontrer une Américaine incroyable et j’ai travaillé mon anglais avec elle pendant deux ans. Très peu de gens ont eu un formateur aussi intelligent. Puis, une autre amie américaine m’a dit que je devrais traduire. Et ça a été le début des ennuis ! (rire) Évidemment, tu imagines alors que tu vas aller frapper à la porte des maisons d’édition et traduire Joyce, mais cela ne marche pas comme ça.
Mary Higgins Clark, c’est arrivé par hasard. Je me souviens très bien de son premier roman, La maison du guet (Albin Michel). À l’époque, c’était la première fois que la pédophilie était évoquée dans un roman policier. Je n’ai pas oublié la scène où elle parle du talc que le ravisseur utilise.
Je traduis depuis maintenant quarante ans. Je trouve que c’est bien d’avoir aussi vu le monde d’un autre oeil avant de commencer, d’avoir fait autre chose.
Le livre que tu aurais rêvé de traduire.
Alice Munro. C’était elle que je voulais vraiment traduire. Elle était publiée chez Rivages, et j’aimais beaucoup son univers. Les grands, comme Joyce ou Shakespeare, non. J’en suis totalement incapable.
Le livre auquel tu rêves de t’attaquer.
Je ne sais pas… Quand je traduis Cunningham, je suis heureuse.
Ton meilleur souvenir de traduction ?
Barry Unsworth (Belfond). Il n’a pas eu beaucoup de succès en France, seule la critique l’a encensé. Il a une écriture très anglaise, dans laquelle je me suis sentie tout à fait à l’aise. Le traduire coulait de source, ce qui est très bien pour un traducteur.
J’aime aussi beaucoup traduire Michael Cunningham. Je me sens bien dans son univers, son style, et lui est devenu un ami. Quand il est interviewé, il fait un vrai show, il est extraordinaire, mais il déteste ça. Il m’appelle, me demande « j’étais comment ? », « horrible ! » je lui réponds, et on rit. Je l’ai découvert avec La maison du bout du monde (Belfond). Dans Les heures (Belfond), il rend hommage à Virginia Woolf. Je trouve qu’il a une vision très juste des femmes, dont il dresse des portraits incroyables dans ce roman.
Un livre, un dictionnaire, une musique… et une île déserte.
Il faudrait prendre un gros livre, ou un que l’on peut relire souvent… Proust, alors. Je l’ai relu à l’occasion d’une traduction où il était cité. Je ne trouvais pas le passage en question. J’ai appelé Tadié, professeur d’université, grand spécialiste de son œuvre. Il ne savait pas non plus. Je ne connaissais pas personnellement l’auteur que je traduisais, mais je lui ai téléphoné. Sa femme a répondu. « C’est dans le premier paragraphe de la Recherche, me dit-elle, à la dixième ligne. » Ça m’a amusée d’être passée à côté. On a tendance à aller chercher les choses là où elles ne se trouvent pas. Mais j’hésite avec Julien Gracq. Je le relis régulièrement, pour me remettre le français en tête. Ou alors, Under the volcano, de Malcom Lowry. Il y a là la plus belle lettre d’amour jamais écrite.
Pour le dictionnaire, Le Robert. Autrement, il me faudrait une malle cabine pour l’Oxford Dictionary !
Quant à la musique… Je ne travaille qu’en musique. Mon mari s’en étonne toujours. Mais un jour, je vois une interview de Levi Strauss où il dit qu’il ne peut pas travailler sans musique. J’étais toute contente ! Je n’étais pas la seule. Bach, Schubert, Beethoven, Mozart… j’emmènerais tout !
Pour l’île… Moheli, petite île des Comores dont une de mes petites-filles porte le nom. Je pourrais tout emmener à Moheli.
Un chat
Une de mes amies a deux chats noirs jumeaux qu’il est impossible de différencier. Ceux-là me plaisent… mais je préfère qu’ils soient ceux de mon amie ! Les chats, je les aime chez les autres.
Un mot intraduisible
» Tout est intraduisible, mais il faut tout traduire » a dit un jour Brice Matthieussent.
Pour moi, la poésie reste intraduisible. Tu es obligée d’écrire autre chose qui tente de coller le plus possible à l’original.
Mais un seul mot intraduisible ? Là, rien ne me vient à l’esprit.
Le mot de la fin.
Merci.
Propos recueillis par Luce Michel
[/spb_text_block]




